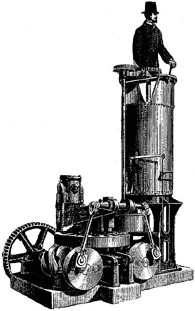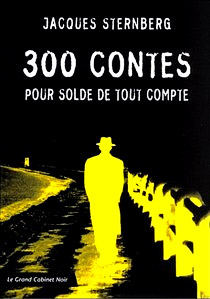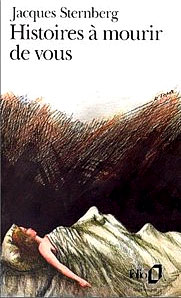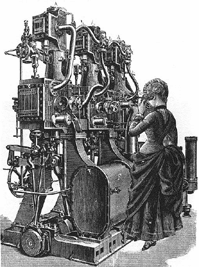| -------------------- |
Jacques Sternberg
|
|||||||
|
||||||||
|
Me
voici en train de remuer des souvenirs et des livres. S'étalent
devant moi La Géométrie dans l'impossible, Mémoires
provisoires, Vivre en survivant, le Dictionnaire des idées
revues, Les Pensées et Profession : mortel, son testament
littéraire. J'ai sur mes étagères son Topor,
divers romans et recueils de nouvelles et de vieilles revues où
sa patte s'est posée : Fiction, Bizarre, Plexus,
Kitsch, Mépris… D'une boîte aux trésors
où je conserve calendriers de pin-ups, pulps et revues obsolètes,
je viens d'extraire le n°33 de mars 1954 de Photo-Monde.
Sous la plume de Jean Gallian, ce mensuel destiné aux amateurs
d'art photographique présente les photomontages d'un inconnu
nommé Sternberg : "Qui est Jacques Sternberg ? Un peu journaliste,
un peu écrivain, un rien dessinateur, quelques nuances de journalisme,
un grand enthousiasme joyeux pour la désespérance et la
neurasthénie, enfin un spécimen typique de la faune qui
hante et a toujours hanté depuis deux mille ans, les jungles
assez civilisées de la rive gauche de la Seine au flanc des coteaux
de Sainte-Geneviève et du Mont-Parnasse. Un avenir improbable
le mènera probablement en un entresol d'une rue tranquille d'Auteuil
où il écrira des contes charmants pour la jeunesse, couronnés
par diverses académies." À lire l'hommage posthume
que lui a décerné le Ministre de la Culture, Renaud Donnedieu
de Vabres, on pourrait penser que cette prédiction s'est réalisée
: "Avec Jacques Sternberg, la littérature francophone perd
l'un de ses représentants les plus singuliers, le créateur
d'un univers déroutant…" Les maigres articles qui ont
suivi son décès ne parviennent pourtant pas à cacher
que Jacques Sternberg n'occupera jamais qu'un strapontin au panthéon
de la République des Lettres. Il était tout à fait
lucide sur ce point et donnait volontiers dans l'autodérision,
comme dans cette notice qu'il rédigea pour le Dictionnaire
des écrivains contemporains de langue française par eux-mêmes1:
"Il serait sans doute téméraire de prétendre
que Sternberg est un écrivain incomparable, mais on peut en revanche
affirmer que son itinéraire d'auteur n'est guère comparable
à celui de ses confrères et contemporains. Peut-être
parce que ce camé d'écriture est resté durant toute
sa vie le cancre qu'il fut à l'école qu'il haïssait,
incapable d'engranger les connaissances, enfermé à double
tour dans sa lucidité d'ignorant imaginatif. Qui a toujours préféré
l'effort physique à la réflexion intellectuelle, la course
aux filles à la vaine recherche d'une métaphysique et
les dérives consolantes aux servitudes du grand cross-country
de la réussite. Cela donna une vie assez agitée malgré
son sur-place dans l'espace et la pensée, une suite de dérapages
provoqués par une constante confusion mentale et le refus de
toute responsabilité sociale, avec comme nerf moteur une véritable
soif d'écrire à travers tout, en état second le
plus souvent, envolée exacerbée qu'aucun refus ou échec
n'arriva jamais à contrer."
|
||||||||
|
Né
le 17 avril 1923 à Anvers dans une famille de diamantaires d'origine
juive, le jeune Sternberg est un gamin rêveur, cancre de vocation.
Son enfance s'achève dans le cauchemar de la seconde guerre mondiale.
La fuite dans le sud de la France ne suffit pas à épargner
à la famille les persécutions. Nuit et brouillard. Son
père ne reviendra pas d'Auschwitz. Enfermé pendant l'hiver
1942 au camp de Gurs (Pyrénées Orientales), l'adolescent
parvient de justesse à échapper à la déportation
et vit deux ans d'errance et d'angoisse sous de fausses identités.
"À travers les camps de travail et les antichambres de la
déportation, dans les prisons et les interrogatoires, au fil
des évasions et du maquis, j'appris à connaître
sur place, de visu, la violence et la terreur, l'injustice et la stupidité,
la folie meurtrière et la veulerie", raconte-t-il dans ses
Mémoires provisoires (1977). "Je traversai ces années
avec l'obscure certitude que jamais je n'arriverai vivant jusqu'à
la fin de cette absurde boucherie et que seule la mort m'attendait au
virage de quelque erreur de parcours. (…) Par miracle, j'en sortis
vivant, par une suite de miracles. Vivant, mais marqué, rancunier,
éveillé à jamais, refroidi, brûlé.
D'autant moins enclin à l'indulgence ou
à la béatitude que mon père avait payé de
sa vie son inaltérable confiance en l'homme...2"
|
||||||||
|
Après
la guerre, il se marie et le jeune couple a très vite un enfant.
Tenaillé par l'envie d'écrire depuis l'adolescence, Sternberg
doit d'abord faire vivre sa petite famille. Après une période
de petits boulots à Anvers et Bruxelles, il s'installe à
Paris. La première opportunité que lui offre l'édition
est un poste… d'emballeur de livres. Il excella, paraît-il,
à confectionner jusqu'à mille colis par jour ! Il occupera
pendant quinze ans des emplois alimentaires, toujours en rapport avec
le commerce de la chose imprimée : "Mal nourri, mal payé,
souvent renvoyé parce que je ne prenais pas mon travail au sérieux,
j'écrivais la nuit, le jour, n'importe où, entre deux
colis, entre deux lettres commerciales, au milieu des clients ou des
circulaires de publicité." Il écrit des contes brefs,
des nouvelles, des romans qui sont régulièrement refusés
par tous les éditeurs. La Géométrie dans l'impossible,
son premier recueil de contes, est publié en 1953 par Eric Losfeld.
La même année, Plon accepte un de ses romans, Le Délit.
Mais l'ouvrage se vend très mal et ne lui ouvre guère
de portes. C'est du côté des revues qu'il parvient peu
à peu à éroder le mur de l'indifférence.
Il est à l'origine du premier Bizarre avec Eric Losfeld,
mais la revue s'arrête au n°2. Il imprime au bureau un fanzine
polycopié, Le Petit Silence Illustré, auquel Hara-Kiri
piquera son slogan : "Si vous ne pouvez pas l'acheter, volez-le
!" Il place des articles dans Arts, dont il sera un temps
le secrétaire de rédaction. Il devient un pilier des premiers
numéros de Fiction, version française de The
Magazine of Fantasy and Science Fiction lancée par Maurice
Renault en 1953, qui se présente comme "une revue littéraire
d'un genre absolument nouveau pour tous ceux qui s'intéressent
à la fiction romanesque dans le domaine de l'étrange".
Rare auteur français dans ce créneau, Jacques Sternberg
apporte aussi à Fiction ses collages. J'ai sous les yeux
le n°21, d'août 1955. L'illustration de couverture, signée
Sternberg, nous montre un personnage solitaire qui semble attendre une
improbable rencontre devant une bouche de métro plantée
en plein désert. Une sélection de contes extraits de La
Géométrie dans l'impossible est précédée
de cette mise en garde au lecteur : "L'impossible est ce où
tout est possible. Le rêve cerne la réalité, la
réalité prend la tangente, les perspectives se défont,
la ligne droite se rejoint elle-même, les trois dimensions se
mélangent et la quatrième vient les recouper… Le
fantastique de Jacques Sternberg fait table rase dans le style de la
bombe H ! Ensuite on ramasse les morceaux - si on peut. Avis aux amateurs
avant usage." Après Auschwitz et Hiroshima, plus rien ne
semble impossible en effet. Le monde d'hier a disparu. Les soucoupes
volantes font leur apparition dans le ciel de la guerre froide. On imagine
un futur peuplé de robots, d'extra-terrestres et de vaisseaux
interplanétaires. On se prépare à la conquête
de l'espace. Dans un mélange d'espoir et d'angoisse, on se demande
si le lointain horizon de l'an 2000 dévoilera un paradis ou un
enfer technologique. Bien avant le "No future"
des punks, l'absurde à la manière de Sternberg renvoie
aux terriens l'image de leurs impasses : "Attention, planète
habitée ! Univers zéro ! Futurs sans avenir !"3
. Ses textes font jaillir "un torrent d'imprécations glacées
contre les mondes présents et à venir"4
mais trouvent peu à peu leur public parmi les fans de science-fiction,
au grand dam des puristes du genre.
|
||||||||
|
Après
diverses variations et rêveries exubérantes qui sont autant
de façons de fuir les médiocrités de la vie de
bureau (L'Employé, 1958, Manuel du parfait petit secrétaire
commercial, 1960, Un jour ouvrable, 1961…), Jacques
Sternberg publie Toi, ma nuit en 1965. Ce roman nocturne et futuriste
sur le thème de la quête de la femme et de la liberté
sexuelle colle à l'air du temps. Si elles ont laissé en
lui leur trace humiliante, les années de refus total des éditeurs
s'éloignent. D'autres portes s'entrouvrent et peu à peu,
Sternberg se fait un nom dans un cercle qui va au-delà des amateurs
de littératures marginales. Alain Resnais lui demande un scénario.
Ce sera Je t'aime, je t'aime (1968). Il tient bientôt une
chronique à France-soir, puis au Magazine Littéraire.
Louis Pauwels lui confie la direction des Anthologies Planète,
un job à sa mesure assorti d'un salaire confortable. Avec le
succès de son roman Sophie, la mer et la nuit (1976),
Jacques Sternberg parvient au faîte de sa carrière. Il
croit pouvoir continuer à vivre et écrire sereinement
dans le sillage de cette réussite, mais cet espoir s'avère
vain. Ses romans suivants ne rencontrent qu'une audience limitée
: Le Navigateur (1976), Mai 86 (1978), Agathe et Béatrice,
Claire et Dorothée (1979), L'Anonyme (1982)…
Il passe des années à peaufiner son Dictionnaire des
idées revues, et tombe de haut quand son éditeur,
Albin Michel, le refuse et le remercie. C'est Denoël qui acceptera
de publier le Dictionnaire, en 1985. Sternberg place encore un
roman chez Julliard, Le Schlemil (1989). Ce sera un nouvel échec
commercial, et le signal de la fin de sa carrière de romancier.
C'est en revenant vers son genre de prédilection, la nouvelle
brève, qu'il retrouvera un peu la faveur des lecteurs. Ses Histoires
à dormir sans vous (1990), puis ses Histoires à
mourir de vous (1991) renouent avec une veine où il puisera
encore des centaines de nouveaux contes, jusqu'à son tout dernier
livre, 300 contes pour solde de tout compte (2002).
|
||||||||
|
||||||||
|
Malgré
un bilan dont d'autres se seraient bien contentés - une cinquantaine
de livres publiés -, Jacques Sternberg n'a cessé de se
vivre en victime des éditeurs, présentés tour à
tour comme bourreaux ou sauveurs. N'ayant vécu correctement de
sa plume que pendant de brèves périodes, il trouvait insupportable
de devoir exercer un "second métier". Ses Mémoires
provisoires sont ironiquement sous-titrés : Comment rater
tout ce que l'on réussit, ce qui fait de lui une sorte de
plagiaire par anticipation des manuels de stratégie de l'échec
du psychologue et humoriste américain Paul Watzlawick, Faites-vous
même votre malheur (1983) et Comment réussir à
échouer (1986). Tirant le bilan de sa
carrière, il avouera cependant : "Au fond, même si
Jacques Sternberg juge qu'il a réussi à écrire
ce qu'il voulait tout en demeurant un raté sur le plan social,
on peut se dire aussi que c'est parfois par une sorte de miracle qu'il
a trouvé des éditeurs pour le publier."5
De fait, les livres de Jacques Sternberg sont dérangeants, inclassables
au premier abord. C'est la marque d'un esprit original et le contraire
d'un passeport auprès du grand public. Ils donnent invariablement
l'impression d'être un peu bancals. C'est qu'ils portent en eux
une blessure, une fêlure que le lecteur perçoit immédiatement
comme une décharge émotionnelle. Dans son autobiographie,
Profession : mortel (2001), Jacques Sternberg se demande pourquoi
sa littérature "déplaît
à presque tous les critiques de la presse qui a quelque audience
et déroute la grande majorité des lecteurs normalement
constitués."6
C'est que tous ne sont pas prêts à se confronter au doute,
à l'inéluctabilité de la mort et de la déchéance,
à la lucidité froide y compris en amour. Il n'y a là
aucun message positif, aucune voie à suivre, aucun exemple à
imiter. Aux lecteurs qu'il entraîne sur sa "planète
terreur", il suggère la fuite comme seul échappatoire,
les hasards du désir en guise de refuge et l'écriture
comme philosophie dernière.
|
||||||||
|
Je
ne peux pas dire que j'adore tous les écrits de Sternberg, et
pourtant tous me touchent, y compris par leurs faiblesses et leurs imperfections.
L'univers de Sternberg est décousu, éclaté. Il
faut surmonter sa désorientation initiale pour y trouver son
chemin. J'ai choisi de conduire cette lecture un peu à sa manière,
à la va comme je te pousse, un mot en amenant un autre à
mesure qu'ils surgissent des touches du clavier. De mon vagabondage
au hasard de ses livres, j'ai ramené les figures les plus hétéroclites.
Mon article apparaîtra peut-être comme un montage bizarre,
mais le monde lui-même n'est-il pas un collage étrange,
où tout est appelé à se mélanger, à
disparaître ou à finir un livre ?
|
||||||||
|
Lire
Sternberg peut procurer autant de plaisir que de malaise. Son œuvre
irradie ceux qui l'approchent de trop près ou la fréquentent
un peu trop longtemps. Comme celle de tous les écorchés
de la littérature, elle est hautement radioactive et sa fréquentation
ne laisse pas indemne. Rescapé de la traque aux juifs organisée
par le gouvernement de Vichy pour fournir aux nazis leur contingent
de victimes, l'expérience fondatrice de
Sternberg en tant qu'écrivain est celle de la cruauté
de la race humaine, "cette engeance perverse, malade, ivre de violence
et de démence" . C'est le cœur ténébreux
de son œuvre. 7
|
||||||||
|
Il
n'est pas rare que ce trou noir se révèle jusque dans ses écrits d'apparence
la plus anodine. C'est d'abord dans des contes, sous les masques du
fantastique, de l'humour noir ou de la science-fiction que Jacques Sternberg
a exploré les contours de ses cauchemars. Un de ses premiers récits
tient en une phrase : "Quand les énormes insectes,
venus d'autre part, virent pour la première fois des hommes, ils notèrent
stupéfaits : "Ce sont d'énormes insectes."8
Le propos est développé dans sa préface
à la réédition d'un classique du roman d'anticipation : "Enormes, plus
hauts que les maisons, car intégrés à leurs gigantesques machines à
trois pieds, les Martiens de la Guerre des Mondes sont des cerveaux
munis de tentacules. Ils ne sont qu'intelligence et leurs moyens de
destruction sont sans limites. Privés de sentiments comme d'entrailles,
ils pensent, ils agissent sans recul. Mais cela ne vous suggère rien,
ces êtres effrayants, insensibilisés, mi-hommes, mi-robots, agressifs
et impitoyablement meurtriers ? Ne soyons pas dupes : tels que Wells
les a décrits, ils sont le portrait sans retouche de ce que sera l'homme
futur au moment où, ivre de conquête, il débarquera sur la planète Mars
ou sur un autre point de l'espace. Tels que nous voyons les Martiens
de Wells, tels nous verront les Martiens. Car ce qui était encore utopie
en 1898 est devenu réalité en 1953, An VI de l'Ere Atomique : entraînés
par une civilisation toute puissante, nous sommes
non seulement à sa solde, comme à sa merci, mais nous risquons fort
de devenir, bardés d'acier et de rayons mortels, les monstrueuses machines
de l'Intelligence."9
Si l'on oublie le prétexte des Martiens,
Wells et Sternberg nous parlent d'un monde où les progrès de la technique
ont accru de façon terrifiante le potentiel agressif et destructeur
de l'espèce prédatrice connue sous le nom d'Homo sapiens.
|
||||||||
|
La
science-fiction est pour Sternberg la forme moderne de la fable. Il
lui consacrera d'ailleurs un essai au début de sa carrière littéraire10.
Plusieurs de ses romans (La Sortie est au fond de l'espace, Attention,
planète habitée…) et une multitude de récits courts en épousent
le prétexte. La verve avec laquelle il projette des histoires fantastiques
sur l'écran noir de ses obsessions est intarissable ; on lui attribue
plus de 1800 contes, écrits sur un demi-siècle. Il rêva à la fin de
sa vie de réunir en un volume toutes ces histoires qu'il tenait pour
le meilleur de son œuvre : "Il ne me faudrait pas plus de quinze jours
pour faire, sur un parcours d'environ 2000 pages, l'incontournable chef
d'œuvre que jamais aucun de mes cinquante livres publiés ne pourrait
égaler. Soit, rassembler en une seule masse tous mes contes généralement
brefs, mes longues nouvelles triées sans indulgence, et surtout reprendre
dans mes seize romans certains chapitre particulièrement
réussis qui sont presque toujours très compréhensibles
en dehors du contexte romanesque et deviennent tout naturellement des
nouvelles parfois plus étonnantes que mes vraies nouvelles. Curieux,
mais la tête me tourne et un vertige me prend quand je pense que
ce grandiose projet ne verra jamais le jour."11
En attendant l'hypothétique publication de cet omnibus, on continuera
à goûter, dans l'un ou l'autre de ses douze recueils de
nouvelles, ces histoires douces-amères dont les plus brèves
sont souvent les plus percutantes. Si
je devais n'en choisir qu'un, mon choix irait aux Contes glacés,
illustrés par Topor12.
|
||||||||
|
Je
ne suis pas un grand lecteur de romans et Sternberg ne m'en aurait sans
doute pas blâmé, lui qui portait ce jugement : "Le
roman m'a toujours paru un genre suspect. Il s'agit
d'une littérature écrite sur mesure pour être jetée
à un vaste public, à la criée."13
Il en a pourtant écrit une quinzaine, toujours cités en
tête de sa bibliographie. Son ambition avouée était
de décrocher le jackpot d'un gros tirage. Il aurait aimé
obtenir, avec un vrai succès d'édition, la reconnaissance
officielle du monde littéraire et le statut social correspondant.
Son acharnement à poursuivre cette chimère n'eut d'égal
que son désarroi face à un genre qui n'était visiblement
pas fait pour lui. Il finit par s'en consoler en citant ces propos de
son ami Topor : "Je me suis toujours demandC'est
leur côté imparfait, bricolé, chaotique, qui m'a
fait aimer Le Délit, Un Jour Ouvrable, Un Cœur
froid, et surtout Toi, ma nuit, relu récemment avec
plaisir. Sophie, la mer et la nuit en prolonge le charme. Ce
livre reçut un excellent accueil mais Sternberg, le jugeant d'une
facture trop prévisible, en fut paradoxalement déçu.
Cela ne retire rien aux qualités de ce roman de l'amour fou,
de la mer et de la dérive que j'ai préféré
de beaucoup à ceux qui allaient suivre. Mai 86, un livre
d' "apolitique-fiction" situé dans un futur envahi
par la pollution, m'est tombé plusieurs fois des mains. J'ai
aussi renoncé devant L'Anonyme, ambitieux roman inspiré
par le personnage de Marlon Brando, qui commence admirablement par le
mot "Absurde" mais dont la suite lasse. é pourquoi
tu as si souvent tenu à te battre sur le terrain du roman encombré
de rivaux plus habiles que toi, alors que sur le parcours du conte bref,
tu es sans concurrents." 14
|
||||||||
|
C'est
leur côté imparfait, bricolé, chaotique, qui m'a
fait aimer Le Délit, Un Jour Ouvrable, Un Cœur
froid, et surtout Toi, ma nuit, relu récemment avec
plaisir. Sophie, la mer et la nuit en prolonge le charme. Ce
livre reçut un excellent accueil mais Sternberg, le jugeant d'une
facture trop prévisible, en fut paradoxalement déçu.
Cela ne retire rien aux qualités de ce roman de l'amour fou,
de la mer et de la dérive que j'ai préféré
de beaucoup à ceux qui allaient suivre. Mai 86, un livre
d' "apolitique-fiction" situé dans un futur envahi
par la pollution, m'est tombé plusieurs fois des mains. J'ai
aussi renoncé devant L'Anonyme, ambitieux roman inspiré
par le personnage de Marlon Brando, qui commence admirablement par le
mot "Absurde" mais dont la suite lasse.
|
||||||||
|
Après
avoir lu au dos de l'ouvrage que "des trente livres que l'auteur
a signés, c'est celui qu'il préfère personnellement",
j'ai tenu à aller jusqu'au bout d'Agathe et Béatrice,
Claire et Dorothée. Le titre complet du roman est en fait Agathe
et Béatrice, Claire et Dorothée, Nathalie, Véronique,
Elise, Aurore, Valérie, Catherine, Amélie, Evelyne, Françoise,
Estelle, Nadine, Sophie, Coralie, Pascale, Aglaé, Bérengère,
Isabelle, Corinne, Josiane, Stéphanie, Karin, Mylène,
Virginie, Christine, Juliette, Laurence, Adeline, Pénélope,
Alice, Noëlle, Angélique, Marianne, Ghislaine, Bernadette,
Geneviève, Aurélie, Carole, Sandrine, Danièle,
Elvire, Martine, Albane, Brigitte, Sidonie, Lise, Eliette, Frédérique,
Sibyle, Clothilde, Solange, Viviane, Adèle, Sabine, Eve, Julie,
Blanche, Tulipe, Constance, Haïdé, Eugénie,
ce qui constitue un bon résumé de ce roman-tableau de chasse. Son héros, récemment nommé proconsul d'un bureau où toutes les secrétaires s'appellent Nicole et mouillent au premier regard, se lance dans une course aux amoureuses de plus en plus délirante, jusqu'à ce qu'une beauté fatale mette un point final à cette suite désordonnée de flirts abracadabrants et de coïts furieux, à la 313ème page. Ce roman fiévreux n'a obtenu les faveurs ni des Goncourt, ni du jury du prix Femina, allez savoir pourquoi. |
||||||||
|
Le
fonctionnement bousculé d'Agathe et Béatrice est,
en plus exagéré, celui que Gérard Klein décrivait
déjà dans un article publié dans Fiction en 1965,
"Exécution et apothéose de Jacques Sternberg"15.
Il situait alors ses livres "dans un genre sensiblement extérieur
au roman", l'autobiographie imaginaire : "Les" romans"
de Sternberg décrivent en fait la vie de Sternberg dans un monde
imaginaire, fantastique, inventé, mensonger et éprouvé
à mesure qu'il écrit. Si l'on considère que le
roman installe des personnages fictifs dans un monde aussi véridique
que possible, on voit qu'il s'agit ici de l'opposé, et de l'insertion
de l'auteur, personnage existant, (ou du moins de l'idée qu'il
se fait de lui-même), dans un monde surgi de son imagination.
En s'installant devant sa machine à écrire, Sternberg
pousse une porte et s'aventure ailleurs. (…) Employé perpétuellement
pourchassé par des instances obscures, pied-nickelé de
l'absurde, tantôt clown pathétique ou dérisoire
cow-boy, il avance dans l'univers biscornu qu'il se fournit à
lui-même avec toute l'aisance d'un scout dans un grand jeu. "
Une sorte d'autofiction avant l'invention officielle du genre…
|
||||||||
|
Sternberg
se situait lui-même "entre deux mondes incertains."
Influencé à quinze ans par la lecture enchantée
d'Un certain Plume16,
il a tracé progressivement sa voie dans la mouvance intellectuelle
de l'après-guerre. Le sentiment de l'absurde, l'envie de vivre,
le goût de l'érotisme, une certaine forme d'humour et de
détachement… sont les ingrédients d'un cocktail que
l'on retrouve, diversement dosé, dans les Inscriptions de
Louis Scutenaire, les Histoires blanches d'André Frédérique,
les romans et nouvelles de Boris Vian, les fables de Pierre Bettencourt,
les dessins de Chaval… autant de grands frères auxquels
Sternberg a rendu un hommage appuyé. Il était aussi sensible
aux inventions de Queneau (notamment à ses Exercices de style),
même s'il attribue à celui-ci la responsabilité
de son refus chez Gallimard, l'échec le plus sensible de sa carrière.
|
||||||||
|
Imprégné
d'un état d'esprit, celui du surréalisme et de l'humour
noir, qui invite à bousculer l'ordre des mots ou des images pour
déranger l'ordre mortifère du monde, Sternberg fut aussi
un passeur exceptionnel. Jamais chiche d'une invitation à découvrir
un dessinateur, un artiste ou un auteur resté dans l'ombre, ses
multiples participations à des revues, et ses activités
de directeur d'anthologies furent l'occasion de faire partager ses enthousiasmes.
On lit encore avec plaisir son Petit Sternberg illustré
et son Moi littéraire dans les anciens numéros
de Plexus ou du Magazine Littéraire. Les anthologies
Planète auxquelles il contribua (15 volumes parus de 1959
à 1976) sont encore très recherchées, aussi bien
pour la qualité des textes que des illustrations.
|
||||||||
|
A
la fin des années cinquante, il fut un des premiers à
reconnaître le génie de Topor et à introduire ses
dessins grinçants dans les quelques revues où il avait
ses entrées. Bien que Roland Topor ait été de quinze
ans son cadet, leur proximité d'esprit a des racines communes
; leur regard sur le monde s'est tordu presque pour les mêmes
raisons. Topor est né en 1938 à Paris dans une famille
de juifs polonais installés en France. Il
dut fuir avec ses parents pour aller vivre caché en Savoie quand
un policier du quartier leur conseilla de quitter Paris, juste avant
la grande rafle du Vel d'hiv17.
Sternberg préfacera le premier recueil de dessins de Topor, Les
Masochistes (1960), et Topor illustrera plusieurs livres de Sternberg.
Celui-ci était très fier de la monographie qu'il consacra
à son ami dans la collection Humour/Seghers en 1978. Cet
essai parle bien sûr essentiellement de l'artiste et écrivain
Roland Topor, créateur prolifique et généreux,
amoureux de la vie et attentif aux fissures dans nos esprits. Mais l'on
aperçoit aussi dans ce miroir un reflet de l'homme Sternberg,
et c'est aussi un peu son propre portrait qu'il brosse en évoquant
"le dégoût de la réalité bien grasse
et bien évidente, la haine du travail et des bagnes, la répulsion
pour les choses molles, l'amour des femmes et
des compensations provisoires, la hantise d'avoir assez d'argent pour
survivre dans les meilleures conditions, en sifflotant dans le noir
pour oublier la fatale grande trouille toujours en arrière-plan."18
|
||||||||
|
Les
plus attachants des livres de Sternberg sont ceux où la somme
de ses amours et de ses dégoûts, réunis en un concentré
instable, forme un mélange sulfureux et détonnant. Sa
Lettre aux gens malheureux et qui ont bien raison de l'être
(1972) est l'éloge narquois d'un pessimisme lucide. En 1974,
sa Lettre ouverte aux Terriens clame quelques vérités
violentes. "Cette lettre ouverte a peu de rapports avec une lettre
d'amour", indique-t-il dès la première ligne. Les
titres des chapitres sont autant d'aphorismes inspirés par un
dandysme du Mépris, qu'il revendique à l'encontre des
usages d'un monde pressé d'écarter toute forme de doute
pour s'adonner aux joies de la surconsommation : "La consommation
n'est jamais que la sommation aux cons" ; "L'homme est un
bipède qui a remplacé ses deux jambes par quatre roues"
; "L'homme n'est pas un loup pour l'homme, mais un troupeau pour
quelques loups ; "La terre a toujours été une vallée
de larmes, elle devient une vallée d'alarme"…
|
||||||||
|
Au
moment où le message d'alerte écologique nous dit à
la fois qu'il faut sauver la terre et qu'il est sans doute déjà
trop tard, je ne peux m'empêcher de citer ces phrases prémonitoires
: "Quand on rédigera l'acte de décès de la
planète ce qui, au rythme du progrès convulsif, ne saurait
tarder, il suffira de quelques formules brèves pour tout expliquer.
Victimes : les Terriens. Lieu du décès : la Terre. Cause
du décès : l'enflure maladive de l'industrie et du commerce,
la course à la production. Motif : le goût du lucre. Circonstances
atténuantes : nulles. Amen."
|
||||||||
|
Avant
d'évoquer son œuvre la plus achevée, le Dictionnaire
des idées revues, je voudrais m'attarder sur un livre oublié
qui se trouve être mon préféré. Vivre
en survivant. est paru dans la collection "l'Ecole buissonnière"
chez Tchou en 1977. Son sous-titre est un programme : "démission,
démerde, dérive". Rassurons tout de suite les défenseurs
de la " valeur travail " : il n'est plus disponible chez l'éditeur
et ne risque pas d'être étudié dans les lycées.
Il n'ira pas polluer de jeunes esprits que le marathon des stages, des
petits boulots et des emplois précaires n'auraient pas encore
dégoûtés de l'envie de contribuer au relèvement
national. De sérieux efforts sont nécessaires pour s'en
procurer un exemplaire. Mais alors, quelle récompense ! Cela
vaut tous les livres de prix. D'envoûtantes illustrations de Jean
Gourmelin, la réédition intégrale en fac-similé
du Petit Silence Illustré, le fanzine ronéotypé
de Sternberg, et une initiation à "un autre art de vivre"
où la rêverie conserve toute sa place. C'est une charge
contre les barreaux de ce gigantesque bureau qu'est devenu le monde,
qui se veut une alternative au chantage "travailler et se soumettre
pour survivre". Il y a tant de façons d'y échapper
et de se tenir à l'écart de la servitude volontaire, à
l'instar de Bartleby le scribe répétant obstinément
: "I would prefer not to". La liberté est au bout de
l'insoumission ! Pas seulement la liberté formelle, mais aussi
la liberté intérieure, celle de "rester avec les
gens ou les pensées, les visions ou les sons que j'ai choisi
de fréquenter".
|
||||||||
|
"Ce
refus permanent aura coûté cher à mon compte en
banque", écrit Sternberg. "Mais il aura sauvegardé
quelque chose de bien plus important que le fric : moi." 19
|
||||||||
|
||||||||
|
Comme
on aimerait pouvoir parcourir une rétrospective des collages
de Sternberg, et feuilleter son catalogue ! Mais en dehors des couvertures
qu'il réalisa pour Fiction, et des 96 collages qui illustrent
Les Variations Sternberg pour clavier de machine à écrire,
paru au Pré aux clercs en 1985 et pilonné depuis, on est
malheureusement ici dans le domaine du musée imaginaire. Sternberg
indique avoir abandonné ses découpages après la
publication de ses premiers textes. Dommage ! Les chapitres suivants
déclinent ses autres passions : le jazz, les revues, la voile,
le Solex (eh ! oui), et la dérive "au bord de l'éternel
féminin"…
|
||||||||
|
||||||||
|
Le
Dictionnaire des idées revues, édité par
Denoël en 1985, est certainement le livre auquel Sternberg tenait
le plus. Il y développe l'entreprise commencée avec le
Dictionnaire du mépris, publié en 1972. Ce gros
volume de 420 pages, relié de toile verte et illustré
par Topor, rassemble 1700 noms communs "plus revus et sévèrement
corrigés que vraiment définis", 550 citations qui
parodient les légendaires "pages roses" du Petit Larousse
et 540 noms propres, ceux des créateurs qui ont fasciné
Sternberg. S'il n'est ni le premier, ni le seul à avoir succombé
à la folie du dictionnaire, ce qu'il a accumulé sur une
période de trente ans est impressionnant. Son titre fait naturellement
référence au Dictionnaire des idées reçues
où Flaubert, en annexe à Bouvard et Pécuchet,
prit plaisir à épingler la bêtise de son temps.
Mais le livre-grenier de Sternberg fait plus sûrement penser au
Dictionnaire du diable d'Ambrose Bierce, autre conscience brûlée,
mais par la guerre de sécession, que ses contemporains surnommaient
"Bitter Bierce" (Bierce l'amer). On sourit ou on fait la grimace
devant les définitions de Sternberg l'amer, mais il faut reconnaître
que ses meilleurs traits sont aussi finement acérés que
ceux de ses modèles :
|
||||||||
|
Abattoir : Dès sa naissance, l'homme est promis à l'abattoir sans se laisser abattre pour autant. Et souvent, il y va même avec pas mal d'abattage. Adhérent : Sorte de timbre humain qu'on n'arrive jamais à décoller d'une enveloppe de concepts. Ambition : L'ambition des uns fait l'abolition des autres. |
||||||||
|
La partie des "noms
propres" du Dictionnaire nous livre la liste des créateurs
qui font partie de ses " grandes rencontres ". Autant de pistes
à suivre pour se construire une culture bis en redécouvrant
dans la littérature et les arts des individus qui ont fait confiance
à leur imaginaire pour inventer leur destin et réinventer
leur temps. La liste n'est pas exhaustive mais on peut y puiser au hasard,
chaque notule est une boîte aux trésors. De Chas Addams,
premier cité, à Zouc, la dernière, il n'y a pas
une seule faute de goût. C'est le seul dictionnaire où
il est question d'Edouard Riou, le grand illustrateur des romans de
Jules Verne et des récits de voyage du Tour du monde,
à qui il m'arrive encore d'aller rendre visite quand je veux
emprunter une image magique pour les besoins d'un collage.
|
||||||||
|
Qui
reprocherait à un amoureux de la mer d'être fasciné
par les livres de sable ? D'Avanies à Vicissitudes, c'est
encore l'ordre des dictionnaires que Jacques Sternberg a choisi pour
organiser son livre de mémoires, Profession : mortel.
Une citation de Louis Calaferte, placée en exergue de ces "fragments
d'autobiographie", semble vouloir en donner le ton : "Ce que
je dis n'a aucune importance. Et ce que je ne dis pas n'a pas non plus
la moindre importance."
|
||||||||
|
Ce
"bilan désordonné de fin du moi", laisse une
impression mitigée. "Ils me font rire, ces auteurs de leurs
mémoires qui prétendent les avoir écrites en toute
sincérité", écrit Sternberg à l'article
Liaisons. "Si l'on devait dire sincèrement ce qu'on
a pensé des autres - ses proches ou ses amis s'ils sont toujours
en vie - on se ferait abattre. Et si l'on devait être vraiment
sincère avec soi-même, on se trancherait la gorge."
Il ajoute à la page suivante : "Et pourtant, s'il y a une
phrase de Cioran qui m'a toujours bouleversé, c'est bien celle
qui fusille l'insoluble problème à bout portant : "On
ne devrait écrire des livres que pour y dire ce qu'on n'ose confier
à personne." Ah ! Oui ! Encore faut-il avoir le courage
désespéré de se le confier à soi-même.21"
|
||||||||
|
Une
chose me frappe au terme de ce rapide parcours dans son œuvre :
cet homme que je n'ai jamais rencontré et dont je n'ai partagé
ni les opinions politiques et philosophiques, ni le mode de vie, m'a
cependant beaucoup apporté et souvent interpellé. Faut-il
privilégier la résistance ou la fuite, la stabilité
ou la dérive, l'amour fou ou l'érotisme solaire, l'écriture
au long cours ou l'art de faire court, la recherche du succès
ou le bricolage créatif suivant ses envies du moment ? Sternberg
s'est posé toutes ces questions, y répondant de façon
plus ou moins satisfaisante pour son propre usage et sans la moindre
prétention à servir de modèle. Il
rejetait toute forme de métaphysique et de prosélytisme,
préférant les pirouettes verbales aux théories
fumeuses : "Ce qu'il y a de risible avec les grands problèmes
de la vie, c'est qu'on peut en dire n'importe quoi, on n'a jamais tort.22"
|
||||||||
|
Dans
ses moments de doute, il lui arrive de se présenter comme l'idiot
galactique : "De tous les écrivains publiés, je suis
sans doute le plus vraiment, le plus profondément ignorant. (…)
Je ne fais rien que déranger, dérouter,
déstabiliser. Mais je n'apprends rien au lecteur, je ne l'instruis
pas, je ne lui donne pas à PENSER"23.
Il nous laisse pourtant une œuvre qui, quoi qu'il en dise, incite
non seulement à rêver mais aussi à réfléchir
et à créer. Malgré les manques et les défauts
revendiqués, Jacques Sternberg eut le courage, l'immense courage
de pousser ses passions jusqu'au bout, et d'abord la passion d'écrire
qu'il a cultivée avec une obstination peu commune. Pour parvenir
à être publié, il a pratiqué presque tous
les métiers en rapport avec le livre : emballeur, dactylo, secrétaire,
journaliste, rewriter, jusqu'à directeur de collection. Quand,
au risque de lasser le lecteur, il revient sans cesse sur le récit
de ses années de galère, de refus par tous les éditeurs,
sur le manque de reconnaissance du public et du monde littéraire,
c'est de cela qu'il nous parle : du chemin parcouru, toujours insuffisant
à ses yeux, et de la démesure de son investissement personnel
dans l'écriture. Quand il s'insurge contre la mort, c'est parce
qu'il a appris durement à ses dépens qu'une seule vie
ne peut suffire à qui veut la vivre pleinement, à plus
forte raison s'il faut en passer la moitié prisonnier d'obligations
médiocres.
|
||||||||
|
Quand
on y pense, quel raté magnifique ! Il a tout tenté et
nous laisse en héritage la narration de ses périples dans
l'impossible. C'est le vrai héros moderne : l'individu qui se
débat dans un monde devenu fou et cherche dans les douceurs du
cocon, la chaleur des femmes, les plaisirs de l'écriture et les
joies du bricolage créatif l'antidote aux angoisses que la bêtise
et l'aveuglement de l'époque ajoutent à la connaissance
de notre finitude. Hyper conscient des limites de l'existence dans notre
société "de haute consommation et de basse lucidité",
conscient aussi de ses propres limites, Sternberg était en insurrection
permanente contre elles. L'un de ses plus beaux textes, où il
évoque avec pudeur la déchirure que fut la déportation
et la mort de son père, se termine par ces mots : "Verser
tout naturellement dans la marginalité ne m'a jamais été
très difficile. Je n'ai presque jamais été d'accord
avec quiconque. Que ce soit un don ou une tare,
je n'en sais rien. Je sais simplement que ce n'est pas une attitude,
une pose, mais au contraire ce que j'ai de plus vrai, de plus sincère,
au fond de moi.24"
|
||||||||
|
La
complexité d'un homme ne saurait être lyophilisée
en quelques caractères imprimés, malgré la déplorable
habitude de résumer une existence en deux traits et une croix.
Je suis conscient de la grossièreté du portrait littéraire
ébauché dans les pages qui précèdent ; j'espère
cependant avoir été un peu moins caricatural que ce que
j'avais lu jusqu'à présent à propos d'un auteur
qui mérite mieux que le purgatoire où il est entré
de son vivant.
|
||||||||
|
Au
final, je me pose toujours la question : "Qui êtes-vous,
Jacques Sternberg ?"
|
||||||||
|
Et
je ne peux que répondre, comme vous l'aviez fait à propos
de Chas Addams, dans un de vos premiers articles pour Bizarre :
"Je n'en sais rien."
|
||||||||
| Vos livres parlent pour vous. | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||